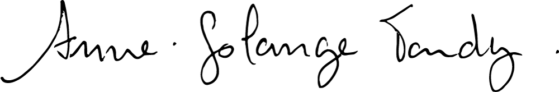Nous avons toute sorte d’idées folles à propos des artistes. L’une des plus répandues : Création marcherait main dans la main avec Souffrance.
J’ai longtemps eu le fantasme de l’artiste maudite écrivant des vers qui lui labourent les tripes afin que de cette noirceur existentielle jaillisse la lumière. Puiser dans les sombres recoins de mon être m’apparaissait non pas comme une possibilité – ce qui est une évidence, la littérature et toutes les formes d’art l’ont assez prouvé – mais comme une condition à la création. Le premier projet sérieux de roman sur lequel j’ai écrit impliquait par exemple une enfant violée par son père. Il avait pour ambition d’explorer ce qui se passait dans la tête d’un homme capable de se conduire à la fois comme un monstre et comme le père-et-mari-parfait. Un scénario d’une grande gaité.
Bien des années plus tard – et sans renier les rêves alchimiques de ma jeunesse – je me sens plus adepte d’une autre vision de la créativité : celle du jeu, de la joie, de la liberté. Viser ce que l’on pourrait appeler une forme d’enfance éveillée, consciente.
Dans la lettre de la semaine dernière, j’évoquais rapidement le conte des trois métamorphoses de Nietzsche, tiré d’Ainsi parlait Zarathoustra où l’enfance est l’ultime métamorphose de l’esprit. Non pas l’esprit revenu en enfance, mais l’esprit, parvenu à l’enfance. Libre et innocent. Créateur, vivant. En tout cas, c’est comme cela que je le comprends
Mais sincèrement, c’est plus facile à dire qu’à faire. À concevoir qu’à vivre.
On cède si vite à la panique ! Quand je me vois transpirer de toutes mes insuffisances, trembler la gorge sèche devant un projet où il n’est pourtant question de rien d’autre que de faire exactement ce que j’aime et ce à quoi j’aspire, il est clair que j’ai encore un long chemin devant moi. Lorsque cela m’arrive, quand je vacille devant l’immensité de mes attentes et qu’ainsi je me coupe de la Joie de créer, j’ai tout de même un certain nombre d’antidotes.
La première : m’accrocher. Pour l’avoir expérimenté un million de fois, je sais désormais que l’inconfort est toujours transitoire et qu’en persévérant, je finis toujours par obtenir « quelque chose ».
La deuxième : pour m’éclairer, je me chauffe à la lumière de ceux qui me donnent le sentiment d’avoir « accédé à l’enfance ». Ceux que j’appelle mes Muses. Mes guides. Tenez, ces lignes-là, par exemple :
![]()
C’était l’hiver sur Belleville et il y avait cinq personnages. Six, en comptant la plaque de verglas. Sept, même, avec le chien qui avait accompagné le Petit à la boulangerie. Un chien épileptique, sa langue pendait sur le côté.
La plaque de verglas ressemblait à une carte d’Afrique et recouvrait toute la surface du carrefour que la vieille dame avait entrepris de traverser. Oui, sur la plaque de verglas, il y avait une femme, très vieille, debout, chancelante. Elle glissait une charentaise devant l’autre avec une millimétrique prudence. Elle portait un cabas d’où dépassait un poireau de récupération, un vieux châle sur ses épaules et un appareil acoustique dans la saignée de son oreille. A force de progression reptante, ses charentaises l’avaient menée, disons, jusqu’au milieu du Sahara, sur la plaque à forme d’Afrique. Il lui fallait encore se farcir tout le sud, les pays de l’apartheid et tout ça. A moins qu’elle ne coupât par l’Érythrée ou la Somalie, mais la mer Rouge était affreusement gelée dans le caniveau. »
Ce sont les premières lignes de La fée carabine, deuxième roman de la série des Malaussène, de Daniel Pennac. Elles me donnent l’impression que n’importe qui, après avoir lu ça, devrait avoir une envie folle de devenir écrivain.
J’ai aussi toujours près de moi ces quelques mots :
![]()
Parfois, Enid aurait préféré avoir un peu moins de soeurs.
— Deux m’auraient suffi, confia-t-elle à Gulliver Doniphon qui partageait avec elle la banquette du car scolaire.
Gulliver se pinça la paupière gauche, examina avec tendresse son pouce où trois cils venaient de rendre l’âme :
— Si tu n’avais que deux soeurs, tu choisirais qui?
Enid se pencha pour contempler, très intéressée elle aussi, les cils défunts de Gulliver.
— J’en sais rien. J’ai pas dit que je choisirais.
— Quatre moins deux égale deux. Si deux suffisent, celles qui restent sont à mettre à la poubelle.
Enid fixa Gulliver avec perplexité, vaguement choquée même. Il expédia d’une pichenette désinvolte les cadavres de cils en direction du dossier de devant. Gulliver Doniphon avait sept frères et soeurs.
— Faudrait pouvoir faire un roulement, conclut-il. Un jour l’une, un jour l’autre.
Le car freina sur cette improbabilité. Enid dit salut à Gulliver puis à la cantonade avant d’empoigner son sac à dos. Elle était la seule élève à descendre à cet arrêt. »
Cette fois, il s’agit des premières de la série de quatre romans Quatre soeurs, de Malika Ferdjoukh, que j’ai déjà lue, relue et re-rerelu, et conseillée avec succès un nombre incalculable de fois. Il y a dans cette plume une jubilation de l’écriture qui me transporte à tous les coups.
Qui me donne envie « de m’y mettre ».
Car pour finir, c’est probablement tout ce que nous avons à faire : chercher nos Muses. Quels que soient nos rêves, nos plans, nos grands espoirs, convoquer toutes les forces – en nous et autour de nous – qui nous aident à nous mettre à l’ouvrage.
Je vous souhaite une belle fin de semaine, à jeudi prochain !
Anne-Solange
Vous aimez les Pochettes Surprises ?
Recevez des surprises tous les jeudis par mail
« Pochette Surprise » est une newsletter gratuite, envoyée tous les jeudis. Une fois inscrit.e, vous avez à tout moment la possibilité de vous désabonner et/ou vous réabonner.

☞ J’étais adolescente, lorsque j’ai entendu parler pour la première fois de Daniel Pennac, de sa Fée carabine * et autres romans facétieux. Mon amie L. les étudiait au collège et c’était les romans qui avaient fait « tilt » pour elle. Qui avaient fait passer la lecture d’état de corvée à celui de refuge, de plaisir et d’émerveillement. Avec moi, ça n’avait pas pris. Il a fallu un bon nombre d’années avant que je sois prise de ce saisissement amoureux instantané qui m’a emportée à la lecture des lignes que je vous ai copiées plus haut.
☞ Quatre soeurs * est le premier roman que j’ai lu de Malika Ferdjoukh. Elle fait partie de ces rares auteurs dont j’ai su, avant même d’avoir tourné la première page, que je lirai chacun de ses écrits avec délectation. Je ne me suis pas trompée. Depuis, j’ai lu – entre autres – Les joues roses, La bobine d’Alfred*, le premier tome, magistral, de Broadway Limited* et le deuxième, sorti en novembre et dévoré avec un égal plaisir : Broadway Limited : un shim sham avec Fred Astaire*.
Avant de lire la série des Quatre soeurs*, j’ai d’abord découvert la version bande dessinée, adaptée par la merveilleuse Cati Baur dont je ne saurais trop vous conseiller la lecture conjointe, en quatre tomes également : Enid, Hortense, Bettina, Geneviève.
☞ Et, pour en revenir à Ainsi parlait Zarathoustra* j’ai reçu la semaine dernière beaucoup d’encouragements de votre part à poursuivre ma lecture (ainsi qu’un certain nombre d’aveux d’abandon ^^), je vais donc essayer de lui trouver une petite place. Mais surtout, en faisant des recherches sur le conte des trois métamorphoses, je suis tombée sur cet article du Monde, que j’ai trouvé très éclairant et intéressant, à propos justement de la dernière métamorphose, celle du lion à l’enfant.